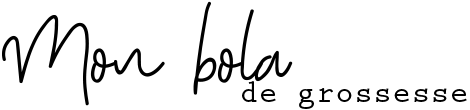Certaines pratiques médicales, pourtant officiellement déconseillées, continuent de marquer profondément les femmes qui les subissent lors de leur accouchement. Parmi elles, l’expression abdominale représente l’une des formes les plus controversées d’intervention obstétricale.
Interdite depuis 2007 en France, cette pratique persiste pourtant dans de nombreuses maternités, laissant derrière elle des traumatismes physiques et psychologiques durables.
Sommaire (A lire dans cet article)
Qu’est-ce que l’expression abdominale ?
L’expression abdominale se définit comme l’application d’une pression sur le fond de l’utérus avec l’intention spécifique de raccourcir la durée de la deuxième phase de l’accouchement. Concrètement, il s’agit d’appuyer fortement sur le ventre de la femme qui accouche pour accélérer l’expulsion du bébé.
Cette manœuvre consiste à exercer une pression intense, parfois avec les mains pointées profondément dans l’abdomen, parfois avec les avant-bras, voire en s’appuyant de tout son poids sur le ventre de la parturiente.
L’objectif affiché est d’écourter la phase d’expulsion, période allant de la dilatation complète du col à la naissance de l’enfant par voie basse.
La Haute Autorité de Santé est formelle depuis 2007 : il n’existe aucune indication médicalement validée pour réaliser une expression abdominale.
Une pratique officiellement interdite mais encore pratiquée
Bien que la Haute Autorité de Santé (HAS) recommande l’abandon de cette pratique depuis avril 2007, les chiffres révèlent une réalité alarmante. Selon les enquêtes menées par le Collectif Interassociatif Autour de la Naissance (CIANE), près d’une femme sur cinq affirme avoir subi une expression abdominale lors de son accouchement.
Des statistiques préoccupantes
Les données collectées auprès de plus de 25 000 femmes entre 2010 et 2016 montrent que cette pratique touche particulièrement les primipares, avec un tiers des premiers accouchements concernés. Pour les accouchements suivants, le taux demeure élevé à un sur sept. Ces chiffres suggèrent qu’une femme sur quatre sera exposée à cette pratique au cours de sa vie reproductive.
Plus inquiétant encore : dans 82% des cas, l’expression abdominale est pratiquée sans demander l’avis de la femme et sans obtenir son consentement.
Cette absence totale de consentement éclairé constitue en soi une violation des droits fondamentaux des patientes, tels qu’établis par la loi Kouchner de 2002.
Les variations selon les établissements
Le CIANE souligne également des disparités importantes selon les types d’établissements. Le taux d’expression abdominale s’avère plus élevé dans les maternités privées (38% en niveau 1) que dans le secteur public (25%). Cette différence pourrait s’expliquer par une pression temporelle accrue lorsque les obstétriciens sont appelés par les sages-femmes dans les établissements privés.
Les conséquences physiques de l’expression abdominale
Loin d’être anodine, cette pratique expose les femmes à de nombreuses complications physiques, dont certaines peuvent s’avérer graves voire exceptionnellement mortelles.
Les traumatismes courants
Parmi les conséquences fréquemment rapportées, on trouve des douleurs abdominales persistantes qui peuvent durer plusieurs semaines après l’accouchement, des ecchymoses importantes sur le ventre, parfois accompagnées de vaisseaux éclatés sous la peau. Les témoignages font également état de fractures de côtes, résultat d’une pression trop intense exercée sur la cage thoracique.
Les lésions périnéales constituent une autre conséquence directe de cette manœuvre. En forçant l’expulsion avant que le périnée ne soit suffisamment préparé, l’expression abdominale augmente le risque de déchirures graves nécessitant des réparations chirurgicales complexes.
Les complications graves et exceptionnelles
Dans de rares cas, l’expression abdominale peut entraîner des complications potentiellement mortelles. La HAS recense parmi ces risques exceptionnels : la rupture de la rate, la rupture hépatique, la rupture utérine ou encore des hémorragies internes massives.
Le témoignage de Lucie, publié par La Maison des Maternelles, illustre dramatiquement ces risques. Suite à une expression abdominale pratiquée par un interne, elle a développé une hémorragie interne causée par le détachement complet de l’artère splénique de la rate. Cette complication a failli lui coûter la vie, nécessitant plusieurs heures de chirurgie d’urgence et un transfert en centre hospitalier spécialisé.
Le traumatisme psychologique : une blessure invisible
Au-delà des séquelles physiques, l’expression abdominale provoque fréquemment un traumatisme psychologique profond et durable. Le vécu de cette expérience est régulièrement décrit comme une agression, une violence subie au moment où la femme se trouve dans une situation de vulnérabilité extrême.
Le sentiment de violation et de perte de contrôle
Les témoignages recueillis font état d’un sentiment de violence intense. Les femmes décrivent une pression qui leur coupe la respiration, les empêche de pousser efficacement et génère une panique immédiate. Plusieurs rapportent avoir eu l’impression de ne plus avoir aucun contrôle sur leur corps et leur accouchement.
Cette perte d’autonomie, combinée à l’absence de consentement, transforme ce qui devrait être un moment d’accomplissement en une expérience traumatisante. Certaines femmes utilisent même le terme de « barbarie » pour qualifier ce qu’elles ont vécu, décrivant des soignants qui s’asseyent littéralement sur leur ventre sous prétexte qu’elles ne poussent pas assez fort.
Les séquelles à long terme
Les conséquences psychologiques peuvent persister bien au-delà de l’accouchement. Plusieurs femmes développent un syndrome de stress post-traumatique, avec des flashbacks, de l’anxiété et de l’évitement. Ce traumatisme peut impacter profondément le lien mère-enfant, la vie de couple et la sexualité.
Pour beaucoup, la perspective d’une nouvelle grossesse devient source d’angoisse majeure. La peur de revivre une expérience similaire conduit certaines femmes à renoncer à leur désir d’agrandir leur famille.
D’autres développent une méfiance durable envers le système de santé, évitant les établissements médicaux même lorsque des soins seraient nécessaires.
L’expression abdominale comme violence obstétricale
L’expression abdominale s’inscrit dans le cadre plus large des violences obstétricales et gynécologiques. Ces violences se définissent comme tout comportement, acte, omission ou abstention commis par le personnel de santé, qui n’est pas justifié médicalement ou qui est effectué sans le consentement libre et éclairé de la femme.
Un contexte de normalisation de la violence
Marie-Hélène Lahaye, militante féministe et auteure du blog « Marie accouche là », propose un critère simple pour identifier une violence obstétricale : transposer l’acte en dehors du contexte hospitalier. Si, dans la vie quotidienne, cet acte constitue une forme de violence, alors il s’agit de violence obstétricale lorsqu’il est pratiqué pendant l’accouchement.
Appliquer ce raisonnement à l’expression abdominale révèle l’évidence : appuyer violemment sur le corps d’une personne sans son consentement constitue une agression dans n’importe quel contexte. Le cadre médical ne devrait pas autoriser ce qui serait condamné partout ailleurs.
Le déni institutionnel
Malgré les recommandations officielles et l’accumulation de témoignages, le corps médical peine à reconnaître l’ampleur du problème. Le Président du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens de France a pourtant qualifié l’expression abdominale de « faute technique et faute professionnelle grave ».
Paradoxalement, cette pratique reste largement non documentée dans les dossiers médicaux.
Avant 2007, seules 10% des sages-femmes la notaient dans les dossiers. Même après les recommandations, ce taux stagne à 9%, rendant difficile toute traçabilité et tout recours juridique.
Pourquoi cette pratique persiste-t-elle ?
Plusieurs facteurs expliquent la perpétuation de l’expression abdominale malgré son interdiction.
La pression temporelle
Dans un système de santé sous tension, où les équipes sont surchargées et les salles d’accouchement saturées, la tentation d’accélérer le processus demeure forte. L’expression abdominale apparaît alors comme une solution rapide pour libérer une salle ou permettre à un obstétricien de passer à un autre accouchement.
Le manque de formation
Cette manœuvre n’a jamais été codifiée ni enseignée officiellement. Elle se transmet de manière empirique, perpétuant des pratiques obsolètes sans questionnement critique. Certains professionnels, formés avant 2007, continuent d’appliquer ce qu’ils considèrent comme un geste technique « normal ».
L’absence de sanctions
Le fait que cette pratique soit rarement documentée et que les plaintes aboutissent difficilement contribue à son maintien. Sans conséquences réelles pour les praticiens, le changement de pratiques reste limité.
Les alternatives recommandées
Lorsqu’il devient médicalement nécessaire d’écourter la deuxième phase de l’accouchement, des alternatives bien plus sûres existent et sont recommandées par la HAS.
L’extraction instrumentale
Le recours aux forceps, à la ventouse obstétricale ou aux spatules constitue l’alternative privilégiée. Ces instruments, utilisés par des professionnels formés, permettent d’aider à l’expulsion du bébé de manière contrôlée et avec le consentement de la mère.
La césarienne
En fonction du contexte clinique et de l’urgence de la situation, une césarienne peut être pratiquée. Bien qu’il s’agisse d’une intervention chirurgicale comportant ses propres risques, elle présente l’avantage d’être codifiée, enseignée et réalisée dans un environnement contrôlé.
Vos droits et recours possibles
Si vous avez subi une expression abdominale ou toute autre forme de violence obstétricale, sachez que vous disposez de droits et de moyens d’action.
Le consentement éclairé : un droit fondamental
La loi Kouchner de 2002 établit clairement que toute intervention médicale nécessite le consentement libre et éclairé du patient. Cela signifie que vous devez recevoir des informations complètes sur les actes proposés, leurs alternatives et leurs risques, et donner explicitement votre accord.
Vous avez le droit de refuser une intervention, même en situation d’urgence relative. Les professionnels doivent respecter votre décision après vous avoir informée des conséquences possibles.
Les démarches possibles
Plusieurs voies s’offrent à vous si vous souhaitez dénoncer des violences obstétricales. Vous pouvez adresser un courrier à la direction de la maternité pour rapporter votre expérience. Cette démarche permet d’alerter l’établissement et peut contribuer à faire évoluer les pratiques.
La saisine de la Commission des Usagers de l’établissement offre la possibilité d’une médiation. Le Collectif Interassociatif Autour de la Naissance (CIANE) peut vous accompagner dans ces démarches amiables.
Pour les situations les plus graves, vous pouvez déposer une plainte auprès du Conseil de l’Ordre des Médecins ou engager une procédure judiciaire.
En 2021, une femme a pour la première fois lancé une action en justice pour les seules conséquences psychologiques post-partum, sans séquelles physiques, marquant une avancée importante dans la reconnaissance juridique du traumatisme obstétrical.
Préparer son accouchement pour se protéger
Bien qu’aucune femme ne soit responsable des violences qu’elle subit, certaines précautions peuvent aider à prévenir les pratiques non consenties.
Le projet de naissance
Rédiger un projet de naissance vous permet d’exprimer clairement vos souhaits et vos limites. Mentionnez explicitement votre refus de l’expression abdominale et de toute intervention non consentie. Discutez-en avec votre sage-femme et votre obstétricien durant la grossesse.
S’informer et se faire accompagner
Plus vous êtes informée sur vos droits et sur le déroulement de l’accouchement, mieux vous pourrez dialoguer avec les équipes médicales. La présence d’un accompagnant attentif et informé peut également jouer un rôle protecteur en veillant au respect de vos choix.
Choisir sa maternité
Les pratiques varient considérablement d’un établissement à l’autre. N’hésitez pas à vous renseigner sur les taux d’interventions des différentes maternités, à poser des questions lors de la visite et à privilégier les établissements qui respectent la physiologie de l’accouchement.
Vers une prise de conscience collective
Ces dernières années, la parole se libère progressivement sur les violences obstétricales. Les réseaux sociaux, les blogs et les associations ont permis de briser le silence et de faire émerger ce sujet dans l’espace public. Le mouvement #PayeTonUtérus en 2014, puis les témoignages collectés par le CIANE et d’autres collectifs ont révélé l’ampleur du phénomène.
En 2019, le Conseil de l’Europe a adopté une résolution sur les violences obstétricales et gynécologiques, reconnaissant officiellement ces pratiques comme des violations graves des droits humains et une forme de violence fondée sur le genre. Cette reconnaissance institutionnelle marque une étape importante, même si beaucoup reste à faire pour transformer les pratiques sur le terrain.
L’accouchement devrait être un moment respectueux, où chaque femme se sent écoutée, soutenue et en sécurité.
Aucune urgence médicale ne justifie l’absence de communication ni le non-respect du consentement. Il est temps que le corps médical prenne pleinement conscience que la manière dont on accouche impacte profondément et durablement les femmes, bien au-delà de la simple naissance d’un enfant.
Si vous avez vécu une expérience traumatisante lors de votre accouchement, sachez que votre ressenti est légitime. Vous n’êtes pas seule, et des ressources existent pour vous accompagner dans votre processus de reconstruction.